Interviewer Jean-Claude Grumberg relève d’une gageure, tant sa carrière est prolifique. Coscénariste de plusieurs films de Costa-Gavras, il est l’un des écrivains dramaturges les plus joués à travers le monde, avec des pièces qui font œuvre de mémoire vive. La Plus Précieuse des marchandises, son dernier livre, est un conte. Et comme tous les contes, il dit vrai. Il était une fois dans un grand bois une pauvre bûcheronne, un papa, une maman et leurs deux tout petits enfants…
Times of Israël : vous vous définissez comme un « écrivain juif français »…
Jean-Claude Grumberg : Ou Français juif… Cela dépend de l’interlocuteur.
Le journaliste et écrivain Olivier Barrot vous a présenté, quant à lui, comme un « auteur classique de son vivant ». Il est vrai que vous faites partie du cercle très restreint des dramaturges inscrits au répertoire de la Comédie Française, avec Amorphe d’Ottenburg…
La pièce a été montée deux fois. Elle a remporté un grand succès en 1971 et n’a été inscrite au répertoire qu’en 2000 où elle a été remontée pour l’occasion.
Ce ne fut pas une grande réussite.
Primées et adaptées en France et à l’étranger, vos pièces (citons L’Atelier, Dreyfus ou encore Zone Libre…) sont également au programme du bac. Ce qui fait de vous un auteur classique à plus d’un titre…
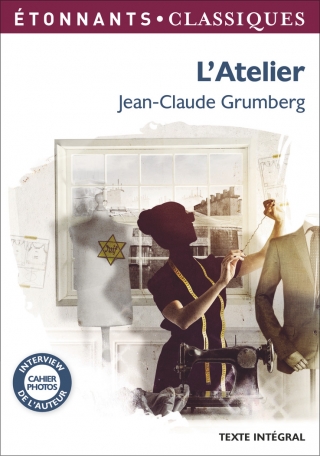
L’Atelier,par Jean Claude Grumberg.
J’ai en effet figuré au programme du Bac Théâtre qui, je crois, est en train d’être supprimé.
L’Atelier est très souvent cité dans des ouvrages scolaires, de même que nombre des pièces que j’ai écrites pour la jeunesse qui sont au programme en primaire.
Avraham B. Yehoshua affirme que les recherches menées sur son œuvre lui ont révélé des aspects de son travail qu’il n’avait pas saisis. Avez-vous connu cette expérience, au gré des si nombreuses analyses de vos
textes ?
textes ?
Cela m’est arrivé mais plutôt à l’occasion de débats. Certaines villes s’unissent parfois pour organiser une sorte de festival ou de rétrospective. Toutes les classes ou les compagnies de la région montent alors des extraits ou des pièces entières. Quelque chose fait que mon travail ne se limite pas aux théâtres institutionnels ou privés. C’est ce qui le fait vivre et perdurer. Des rapports privilégiés s’instaurent avec les lecteurs et les spectateurs de tous âges.
Un jour, lors d’un débat, un enfant m’a recommandé de ne surtout rien couper même si on me le demandait ; un autre m’a consolé en me disant de ne surtout pas m’en faire et qu’un jour, je serais célèbre. Et un garçon d’une dizaine d’années m’a demandé : « Avez-vous connu des échecs ? » J’ai dit oui. Alors, il a répondu : « Bah, moi aussi » !
La libération du camp d’Auschwitz a été commémorée le 27 janvier dernier. Outre la difficulté que rencontrent certains enseignants quand ils veulent parler de la Shoah, la question demeure : comment transmettre sans traumatiser les enfants ? Comment ne pas se laisser submerger par l’émotion à l’évocation de la fin tragique dans des chambres à gaz ? C’est là que l’on prend la mesure des mots du poète Claude Roy souvent rappelés dans les portraits qui vous sont consacrés : « L’auteur tragique le plus drôle de sa génération »…
Claude Roy était capable de faire la part, dans ce que j’écrivais, du tragique et du comique, sans s’offusquer, comme certains le font, que mes pièces puissent faire rire en dépit du tragique. Il s’agit au contraire de faire rire à cause du tragique. Plus c’est tragique, plus on doit rire.
Marcel Cuvelier vous avait repéré et avait accepté de monter l’une de vos pièces, Demain, une fenêtre sur rue. Il avait été parmi les premiers à mettre en scène Ionesco dont Jankélévitch disait qu’il
« déshabille l’homme et montre ses bas instincts ». N’est-ce pas là ce que Cuvelier avait d’emblée débusqué chez vous et ce qui allait nourrir la matière de vos textes ?
« déshabille l’homme et montre ses bas instincts ». N’est-ce pas là ce que Cuvelier avait d’emblée débusqué chez vous et ce qui allait nourrir la matière de vos textes ?
Quand bas instincts il y a. Ce n’est pas le cas dans L’Atelier ou dans Dreyfus. En revanche, dans des pièces comme Rixe ou Les Vacances, qui continuent d’être jouées, c’est, je dirais, la grossièreté de l’homme qui est montrée. Ionesco a eu la chance de vivre vieux, ce qui lui a laissé le temps d’écrire des pièces dans lesquelles apparaît une forme de tendresse et de mise à distance de la monstruosité qu’il dénonçait ou qu’il mettait en scène sans la dénoncer, d’ailleurs, car le fait de mettre en scène suffit à dénoncer…
N’est-ce pas cette mise à nu – la mesquinerie des hommes et leur grandeur, pour reprendre vos mots – que vous avez perçue chez Tchekhov que vous aimez tant ?
Tchekhov, c’est l’humanité. Sans lui, sans ses nouvelles, je n’aurais jamais écrit.
Amorphe d’Ottenburg (1971) et Dreyfus (1974) ont remporté un immense succès. Les théâtres se battaient, semble-t-il, pour les monter…
Pour Dreyfus, j’ai eu du mal…
Dans son dernier ouvrage (Tu finiras clochard comme ton Zola, Ed. de l’Observatoire), Philippe Val écrit, à propos de Mai 1968, que
« l’héroïque France intellectuelle de l’anticolonialisme avait relégué dans l’oubli la honteuse France intellectuelle de la collaboration et de l’antisémitisme ». Est-ce ce même état d’esprit qui vous fait dire que le succès de ces deux pièces n’était pas assuré tant il était audacieux de prononcer le mot « juif » au début des années 1970 ?
« l’héroïque France intellectuelle de l’anticolonialisme avait relégué dans l’oubli la honteuse France intellectuelle de la collaboration et de l’antisémitisme ». Est-ce ce même état d’esprit qui vous fait dire que le succès de ces deux pièces n’était pas assuré tant il était audacieux de prononcer le mot « juif » au début des années 1970 ?

(Tu finiras clochard comme ton Zola, Ed. de l’Observatoire), Philippe Val.
Dreyfus s’est joué au Théâtre de l’Odéon. L’émotion, à la première de la pièce, était palpable et elle ne tenait pas seulement à la qualité de la troupe : depuis la guerre, c’était la première fois que tous les personnages, exceptés deux Polonais de passage, étaient juifs et parlaient yiddish. C’était bouleversant.
À part des livres en yiddish qui n’étaient pas traduits et Schwarz-Bart qui a créé une sorte de choc émotionnel (ndlr Lauréat du Goncourt 1959 pour Le Dernier des Justes), c’était le silence…
En 1979, au moment de L’Atelier, une journaliste, par ailleurs très avenante, m’a dit : « Vous avez écrit Dreyfus qui se passe avant-guerre ; vous avez écrit L’Atelier qui se passe après-guerre. Il manque quelque chose… ». Elle parlait de la guerre, bien sûr. J’ai répondu que je ne me sentais pas en mesure d’affronter le sujet et que, par ailleurs, je n’étais pas certain que le public fût prêt à entendre certaines choses au théâtre.
« Que ce sont, par exemple, les autorités françaises, Laval et Pétain, qui ont insisté pour que les enfants soient déportés ». Sa réponse ? « Mais qu’est-ce qu’on aurait fait avec tous ces enfants sans parents, dans les rues »… La teneur de ce qu’elle m’a dit ce jour-là, je l’ai souvent retrouvée par la suite, exprimées de différentes façons, notamment à travers les propos de Zemmour.
Le crime qui avait été commis n’était pas perçu comme une évidence. Tous les arguments étaient bons pour donner une justification, comme par exemple, que cela avait été une mesure de police visant à ne pas séparer les familles… Il était très difficile de parler.
Le succès vous a rendu malade et déprimé. Sans verser dans le stéréotype, n’est-ce pas là, tout de même, un symptôme très ashkénaze ?
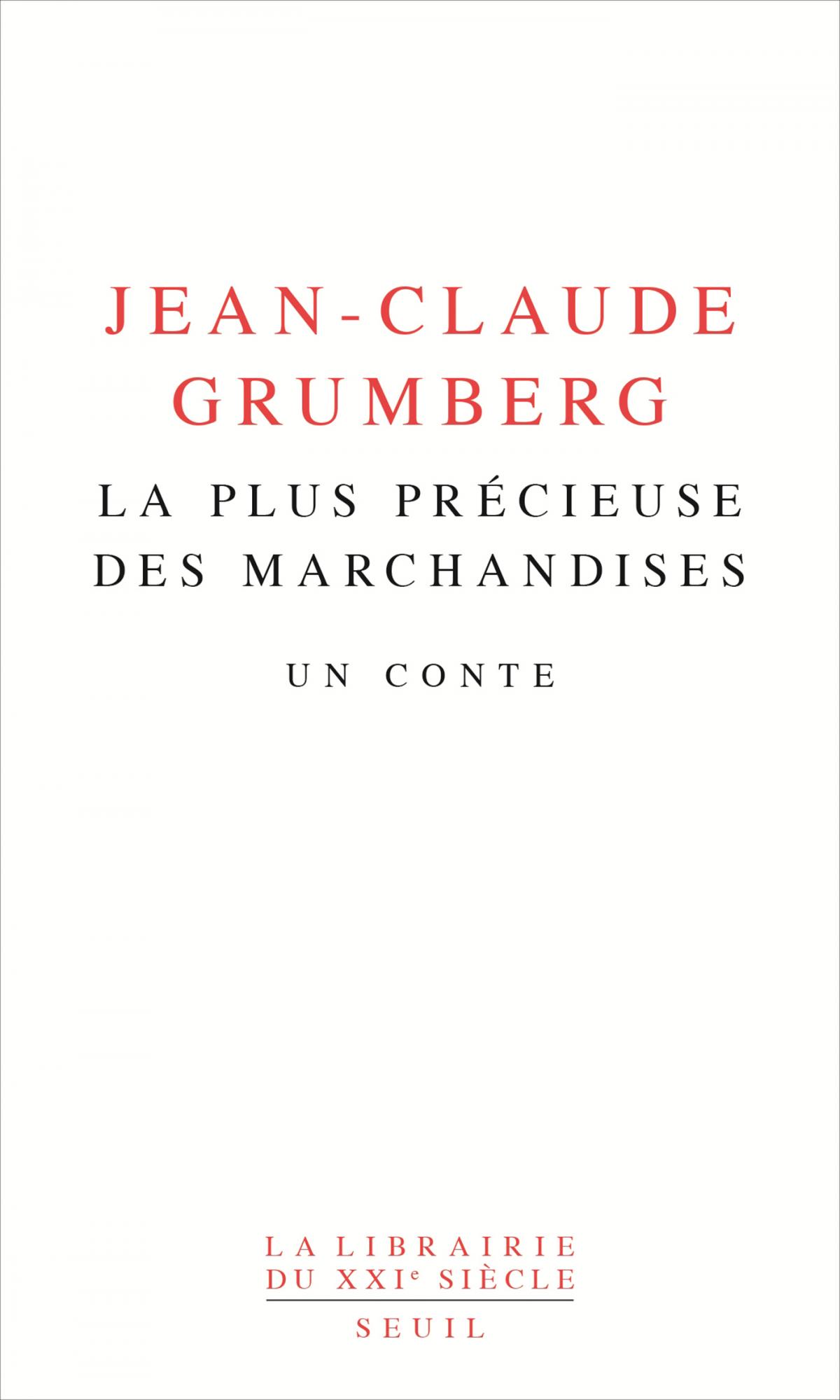
La Plus Précieuse des Marchandises, Un conte, par Jean-Claude Grumberg, Seuil, « La librairie du XXIe siècle »
Laissez-moi vous dire une chose : tous les enfants de déportés ont connu un passage dépressif. Tous, même ceux qui se sont éloignés en changeant de pays, de vie ou de nom.
Nous sommes les victimes de quelque chose que nous n’avons pas vécu. Ce type de succès était difficile. Les scrupules étaient doubles : ne pas trahir et honorer les petites gens qui, comme mon père, n’étaient ni résistants, ni politisés et dont on a considéré qu’ils s’étaient laissés rafler. C’est pour cela que j’insiste sur le fait que ce sont des policiers français qui sont venus arrêter des pères de famille, devant leurs enfants et souvent avec. De la même manière, le succès que rencontre La plus précieuse des marchandises est, lui aussi, difficile. Il se peut qu’il y ait des gens pour me le reprocher.
Nous y venons. Le lecteur fait d’emblée la connaissance d’une pauvre bûcheronne, de son pauvre mari bûcheron et, transportés dans un train, un couple et ses nouveaux-nés jumeaux, un garçon et une fille. Le voyage se fait dans un wagon à bestiaux parti de Drancy. À partir de là, le « Il était une fois » peut commencer… Pourquoi avoir choisi la forme du conte ?
Je pensais écrire un texte pour les enfants, avant que des problèmes de santé ne m’empêchent de travailler mais j’ai continué d’écrire le conte. En fait, tout est parti du jardin Villemin, dans le 10e arrondissement de Paris, où une plaque avait été apposée pour les enfants déportés qui, trop jeunes, n’avaient pas été inscrits à l’école. Mon épouse et moi-même y sommes allés parce que, tous les deux, nous aurions pu être de ceux-là : c’était notre quartier. C’est sur ce monument que j’ai repéré la mention de jumeaux déportés à l’âge de 28 jours… Le seul fait d’en parler me bouleverse. Et là, l’imagination s’est mise en marche et inconsciemment, les choses sont venues.
Dans le train se trouve un vieillard asthmatique qui, selon le narrateur, « avait, depuis sa naissance, tout prévu »…
Ça, c’est ashkénaze !
Cette histoire est très sensible à la notion de l’espace et de la gestuelle : la bûcheronne qui court après le train à travers son bois, les petits papiers griffonnés et jetés qu’elle ramasse ou encore le
« doigt péremptoire, impérieux » que le père des jumeaux pointe vers elle, lorsqu’il la voit à travers la lucarne…
« doigt péremptoire, impérieux » que le père des jumeaux pointe vers elle, lorsqu’il la voit à travers la lucarne…
Il cherche la meilleure solution pour remplir son rôle de père. Le conte et le théâtre imposent une écriture très visuelle. Ce texte n’est pas destiné à être joué mais il pourrait l’être. Il s’agit d’une littérature de l’économie qui s’attache à dire le maximum de choses avec le minimum de mots. Dès lors, l’image surgit plus facilement que dans une longue description qui, certes, permet au style de l’écrivain de s’exprimer mais qui ne laisse pas forcément entrevoir la réalité des lieux.
Un autre mouvement est évoqué : c’est celui des trains qui ont roulé dans le seul but d’éliminer leur « marchandise humaine », comme ce fut le cas lors du pogrom de Iassi * rappelé dans le livre par un déporté : « ils ont fait rouler ce train jusqu’à ce que les juifs meurent de chaleur, de soif, de faim ». Pourquoi avoir, nommément, introduit cet évènement dans le conte ?
J’avais écrit un scénario dans lequel je décrivais ce qui s’était passé en Roumanie mais il ne s’est jamais tourné. Cela m’est venu parce que, là encore, ce pogrom n’est pas le fait de l’armée allemande. C’est la population roumaine, les voisins, les autorités de la ville, etc… Comme le reste, c’est un élément qui surgit pendant l’écriture. Je n’avais pas l’intention d’en parler. Mais que peut-on se dire dans un wagon, en 1942, alors que la nouvelle du pogrom de Iassi, perpétré en 1941, a eu le temps de se propager ?
L’écriture fait alterner des passages plus longs, liés au conte, et des chapitres au rythme plus rapide, dont on sent qu’ils sont minés par l’urgence…
Cette alternance traduit la difficulté qu’il y a d’écrire sur le quotidien des déportés dans le camp – le père – et, en parallèle, sur le quotidien de personnages d’un conte : la bûcheronne, le bûcheron, l’homme à la chèvre, l’homme au chapeau de taupe… Tous ces personnages gravitent autour du véritable sujet du conte : l’histoire de la bûcheronne et du cadeau qu’elle reçoit des dieux.
Même si l’objet de ce livre n’est pas de décrire avec précision le quotidien du camp, n’est-ce pas la première fois que vous allez aussi loin et que vous y pénétrez ?
Il y a déjà, dans L’Atelier, une description précise de l’arrivée et de la sélection.
Une autre dynamique était énoncée dans Mon père. Inventaire : « Plus le temps passe, plus nous nous rapprochons des évènements passés ». Comment expliquer ce mouvement paradoxal ?
Et plus on vit son enfance… C’est paradoxal mais c’est comme ça. En tout cas pour moi et, je pense, pour beaucoup. Ce que l’écrivain doit décrire n’est pas le fait qu’ils sont morts. Ce qu’il doit dire, c’est qu’on a tué des vivants, un par un. Quand vous êtes enfant et qu’on vous explique qu’il y a eu six millions de morts dont votre père et votre grand père, ça ne veut pas dire grand-chose. C’est petit-à-petit que l’on individualise. C’est cette individualisation qui instille la vie. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ces vingt huit jours de vie des deux enfants m’ont rendu fou alors que je lis des horreurs depuis des années…
Dans un monde où la bûcheronne clame que les « dieux ne peuvent pas penser à tout parce qu’ils ont tant à faire ici bas », c’est tout de même le « châle divin » dans lequel le père a enveloppé l’enfant qui parvient à amadouer plusieurs personnages. Est-ce une petite concession de l’écrivain non croyant ?
…Oui… Enfant, je jouais avec celui de mon grand-père… Mais, s’agissant du passage auquel vous faites allusion, je pense que de toute façon l’homme à la chèvre et à la tête cabossée se serait laissé amadouer, quand bien même la bûcheronne ne lui aurait pas offert le châle en échange de son lait.
Le convoi qui transporte et dépose la plus précieuse des marchandises est le convoi 49 parti de Bobigny gare le 2 mars 1943 et arrivé le 5 mars à son terminus. Parmi le millier de juifs, se trouvait Zacharie Grumberg, votre père. Le 11 novembre 42, dans le convoi 45, se trouvait Naphtali Grumberg, votre grand-père… Le sous-titre de votre vie pourrait-il être : « Comment j’ai vécu sans mon père et sans père de substitution » ?
C’est en tout cas un bon titre. Un jour, au cours d’un débat, une dame m’a dit : « Vous avez de la chance : votre père a été déporté. Vous avez un sujet ! ». Alors, je lui ai répondu : « Ayez confiance en l’avenir. Vous allez peut-être vivre une chose horrible qui vous permettra, à vous aussi, de trouver un sujet . Gardez confiance ». En même temps, elle avait raison : si j’écris, c’est parce qu’il s’est passé ce qui s’est passé. Qu’aurais-je fait sinon ? Je serais sans doute devenu tailleur.
Encore que, à lire certaines de vos déclarations, vous n’auriez pas fait un très bon tailleur…
J’étais très mauvais. J’ai donc eu une double chance…
Une question, terrible, surgit dans le conte : « Au printemps 1942, était-ce le moment de mettre au monde un enfant juif ? Pire, deux enfants juifs d’un coup »…
En Argentine, la communauté juive n’était pas touchée. Et pourtant, les Juifs se sont arrêtés de faire des enfants vers 1942/1943. Il n’y avait plus d’enfants chez les Juifs. Et puis, il y a eu la bataille de Stalingrad. (ndlr. L’une des grandes défaites de l’armée allemande sur le front de l’Est et un tournant stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale). Neuf mois plus tard, on enregistrait un baby-boom…
Nous laisserons les lecteurs découvrir par eux-mêmes ce conte troublant et sa fin, que vous dotez d’un épilogue s’ouvrant sur une question : «Vous voulez savoir si c’est une histoire vraie ? Bien sûr que non, pas du tout. Il n’y eut pas de trains de marchandises traversant les continents en guerre afin de livrer d’urgence leurs marchandises, ô combien périssables. Ni de camp de regroupement, d’internement, de concentration, ou même d’extermination. Ni de familles dispersées en fumée au terme de leur dernier voyage (….). Rien, rien de tout cela n’est arrivé, rien de tout cela n’est vrai ». Est-ce pour les négationnistes ?
Au-delà des négationnistes, de plus en plus nombreux vont être ceux qui, le temps passant et face à l’inimaginable, n’imagineront pas et diront :
« Non, c’est un conte. Ce n’est pas vrai. Les trains de déportés n’étaient pas prioritaires par rapport aux trains militaires ». Eh bien si. Certes, il y a bien le travail des historiens mais on constate que tout peut être mis en doute. En revanche, ce que l’on ne met pas en doute, par exemple dans Le Petit Poucet, c’est que des parents aient été contraints d’abandonner leurs enfants parce qu’ils crevaient de faim. Ça, on ne peut pas le mettre en doute. Le conte ne peut pas être mis en doute. Le conte est vrai.
« Non, c’est un conte. Ce n’est pas vrai. Les trains de déportés n’étaient pas prioritaires par rapport aux trains militaires ». Eh bien si. Certes, il y a bien le travail des historiens mais on constate que tout peut être mis en doute. En revanche, ce que l’on ne met pas en doute, par exemple dans Le Petit Poucet, c’est que des parents aient été contraints d’abandonner leurs enfants parce qu’ils crevaient de faim. Ça, on ne peut pas le mettre en doute. Le conte ne peut pas être mis en doute. Le conte est vrai.
Vous avez souvent été invité, notamment en Israël, à définir votre rapport à l’Etat hébreu. Quel est-il aujourd’hui ?
Mis à part ses voisins, Israël est évidemment une grande réussite et là aussi, comme souvent en vieillissant, on prend conscience de la force du lien. Ce que je dis toujours, c’est que je n’aimerais pas qu’on me force à partir en Israël. Le fait qu’Israël existe est une garantie pour les Juifs de la Diaspora mais le fait qu’il y a encore une diaspora est une garantie pour les Juifs d’Israel. Donc, si vous m’interrogez sur le lien que j’ai avec Israel, il faut interroger les Israéliens sur le lien qu’ils ont avec moi et la Diaspora en général. Je dirai que nous sommes liés les uns et les autres, j’espère pour le meilleur et, sinon, pour le pire…
Dans le conte, les survivants du camp répètent : « ça va bien finir par finir ». Les sursauts populistes et la résurgence de l’antisémitisme en France peuvent-ils être perçus comme les rebonds d’une idéologie qui, décidément, semble ne pas finir ?
Ça ne finit pas. Peut-être faudrait-il examiner la nature de l’antisémitisme en France. L’antisémitisme littéraire, culturel, économique… On s’apercevrait que Guérin et Drumont faisaient des affaires : l’antisémitisme leur rapportait de l’argent. L’antisémitisme était une économie qui faisait vendre des journaux.

Affiche de campagne du parti antisioniste de Dieudonné et Alain Soral de 2009. (Crédit : capture d’écran YouTube)
Messieurs Dieudonné et Soral vivent également de l’antisémitisme dont ils ont fait leur fonds de commerce. Et ils en vivent d’ailleurs très bien. Ils sont antisémites, certes, mais c’est leur métier, leur profession. Ces gens suscitent d’ailleurs des vocations et il y a même beaucoup de bénévoles.
Ils produisent des idées, dont l’une des plus simples consiste à dire que le malheur du monde vient des Juifs. Je leur dis une chose : « Si vous gagnez de l’argent en étant antisémites, je peux comprendre que vous continuiez. Mais n’incitez plus au meurtre, ne tuez plus ». Il peut y avoir des antisémites mais ce qui ne doit pas se produire, c’est qu’ils nous tuent. Le reste, on s’en arrange. On peut très bien ridiculiser leur antisémitisme et le réduire, en paraphrasant l’expression désignant le « socialisme des imbéciles », à la passion des imbéciles. Tout cela n’est pas nouveau. On a bien vu qu’au moment où on s’est mis à tuer les Juifs, personne au monde n’en a voulu. C’est comme ça. Face à cet état de fait, on doit écrire et faire en sorte que nos enfants et ceux des autres aient envie de vivre, sans être écrasés par la peur.
*Pogrom lancé le 27 juin 1941 par le régime fasciste roumain contre la population juive. Il s’est soldé par la mort d’au moins 13 226 juifs selon les autorités roumaines.





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire